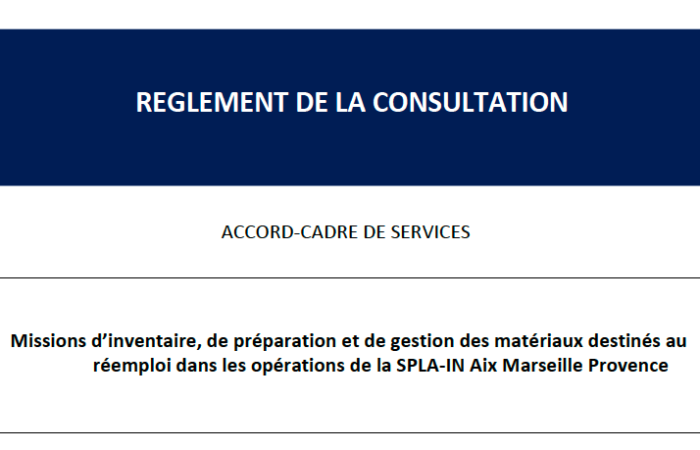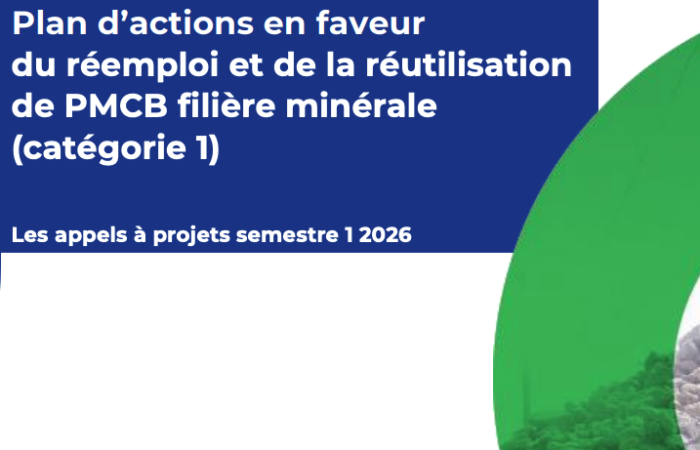Publié par Le Moniteur, le 22 novembre 2024
Le texte européen adopté le 13 juin 2024 devrait faciliter le réemploi de matériaux et équipements, grâce notamment au passeport numérique de produit.

Le règlement Ecoconception (ou ESPR pour Ecodesign for Sustainable Products Regulation) [1], publié le 28 juin 2024, est passé relativement inaperçu en France au milieu de la préparation des Jeux olympiques et du déroulement des élections législatives anticipées. Ce texte contient pourtant des avancées majeures qui vont impacter le secteur du bâtiment et tous ses acteurs, des maîtres d’ouvrage aux fabricants de matériaux en passant par les entreprises de travaux.
Un cadre général. Un bref rappel historique s’impose. Ce règlement a été proposé par la Commission européenne le 30 mars 2022 dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’économie circulaire et du pacte vert pour l’Europe. A l’origine, un constat sans appel : la demande de matières premières secondaires reste aujourd’hui limitée au sein du marché intérieur, et les modèles économiques circulaires peinent à s’imposer. Le Parlement européen et le Conseil ont donc décidé d’adopter un texte unique et complet pour « garantir que tous les produits mis sur le marché de l’Union deviennent de plus en plus durables et remplissent les critères de l’économie circulaire », comme l’explique son préambule.
Ce règlement est donc un cadre général, qui doit donner lieu à l’adoption par Bruxelles de nombreux actes délégués par groupes de produits spécifiques dans les prochains mois et années. Pour le secteur du bâtiment, il annonce des obligations d’écoconception pour les produits, matériaux et équipements, qui vont notamment changer la donne pour le réemploi de ces éléments, ainsi que des exigences minimales dans les marchés publics pour contraindre les maîtres d’ouvrage à se tourner vers l’économie circulaire.
Des exigences d’écoconception des produits et matériaux
Le cœur du dispositif consiste à imposer deux types d’exigences d’écoconception : celles portant sur les performances des produits et/ou celles relatives à l’information. Des familles de biens et d’équipements sont déjà identifiées comme prioritaires et l’articulation avec le règlement pour les produits de construction (RPC) est prévue (2).
Des exigences de performance, la circularité obligatoire. Le règlement Ecoconception prévoit que la Commission devra fixer des exigences relatives aux aspects suivants (article 5) : la durabilité ; la fiabilité ; la possibilité de réemploi ; la possibilité d’amélioration ; la réparabilité ; la possibilité d’entretien et de reconditionnement ; la présence de substances préoccupantes ; la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique ; la consommation d’eau et son utilisation efficace ; la consommation des ressources et leur utilisation efficace ; le contenu recyclé ; la possibilité de remanufacturage ; la recyclabilité ; la possibilité de valorisation des matériaux ; les incidences environnementales, y compris l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale ; la production prévue de déchets. Logiquement, les exigences ne porteront pas sur tous ces aspects pour tous les produits.
Les exigences en matière de performance porteront sur les aspects pertinents pour le groupe de biens concernés, sa-chant que cette notion de « pertinence » relèvera de l’appréciation de la Commission. Afin de guider celle-ci dans son travail, le règlement prévoit la création d’un forum sur l’écoconception « prenant la forme d’un groupe d’experts avec une participation équilibrée et effective d’experts désignés par les Etats membres et de toutes les parties ayant un intérêt pour le produit ou groupe de produits en question » (art. 19).
Ce comité devra notamment contribuer à l’élaboration des exigences en matière d’écoconception et fixer des exigences de performance qui seront concrètement exprimées (art. 6) : – soit sous forme quantitative, c’est-à-dire des niveaux minimaux ou maximaux en ce qui concerne un paramètre spécifique ou une combinaison de tels paramètres (par exemple, les quantités minimales de matériaux recyclés devant être intégrées dans la fabrication) ; – soit sous forme non quantitative (par exemple, imposer que le produit soit recyclable).
Des exigences d’information, le passeport numérique. Tout comme les exigences de performance, les exigences d’information seront fixées par la Commission avec l’appui du forum sur l’écoconception et devront permettre d’améliorer les aspects pertinents d’un groupe de produits (durabilité, consommation d’énergie, possibilité de réemploi, recyclabilité, etc.).
Les exigences d’information (art. 7) comprendront a minima celles relatives au passeport numérique de produit et d’autres permettant le traçage des substances préoccupantes tout au long du cycle de vie.
Ce passeport est la véritable révolution introduite par le règlement. Il s’agit d’un outil dématérialisé qui vise à mettre à disposition des acteurs tout au long de la chaîne de valeur les informations utiles et pertinentes relatives aux aspects du produit visé précédemment (possibilité d’entretien et de reconditionnement, recyclabilité, etc. ) mais aussi sa conformité au droit de l’Union européenne (par exemple, le marquage CE).
En pratique, le support de données du passeport (probablement un QR code) sera physiquement présent sur le produit, sur son emballage ou dans la documentation l’accompagnant.
Les clients, les fabricants, les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs, les reconditionneurs, les recycleurs ou encore les associations ou les autorités douanières auront ainsi gratuitement et directement accès au passeport numérique, qui devra être facilement compréhensible et à jour (le règlement allant jusqu’à inviter la Commission à le rendre « convivial » [préambule, point 32]).
Les produits et matériaux de construction concernés. Ce règlement Ecoconception est bel et bien applicable aux produits, matériaux et équipements de construction, et ce, même s’ils relèvent également du RPC.
L’articulation entre ces deux textes est prévue : le règlement Ecoconception ne devra fixer des exigences relatives aux produits finis de construction qu’à titre subsidiaire, si les exigences posées par le RPC sont inadéquates ou insuffisantes pour atteindre les objectifs de durabilité et de circularité.
Par ailleurs, en ce qui concerne les produits liés à l’énergie utilisés dans la construction (par exemple, les dispositifs de chauffage, de production d’eau chaude…), les exigences de durabilité fixées par le règlement Ecoconception prévalent sur les règles arrêtées par le RPC.
Le règlement Ecoconception vise ensuite plus spécifiquement les groupes de produits prioritaires (art. 18), parmi lesquels figurent certains matériaux et équipements du bâtiment. Ainsi, dans le premier programme de travail, à adopter au plus tard le 19 avril 2025, Bruxelles devra notamment donner la priorité au fer et à l’acier, à l’aluminium, aux peintures et aux produits liés à l’énergie.
Le texte prévoit enfin, dans ce même article 18, qu’« en l’absence d’exigences adéquates en matière de performance et en matière d’information relatives à l’empreinte environnementale et à l’empreinte carbone du ciment au titre du règlement pour les produits de construction, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception relatives au ciment dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 au plus tôt le 31 décembre 2028 et au plus tard le 1er janvier 2030 ».
Ce texte donnera lieu à l’adoption par Bruxelles de nombreux actes délégués par groupes de produits spécifiques dans les prochains mois et années.
Une révolution favorable au réemploi
On le devine en filigrane au vu des développements qui précèdent : ce règlement est particulièrement favorable au réemploi des matériaux de construction et pourrait bien être le levier tant attendu pour massifier et simplifier ce procédé d’écoconstruction. En effet, les exigences du règlement ne s’appliqueront pas aux produits d’occasion, et le réemploi des nouveaux produits sera considérablement facilité.
Non-applicabilité des exigences d’écoconception aux produits d’occasion. Le règlement Ecoconception est très clair et constant par rapport au droit en vigueur : les produits d’occasion provenant de l’Union, reconditionnés ou non, ne sont pas de nouveaux produits et peuvent circuler sur le marché intérieur sans devoir satisfaire aux actes délégués énonçant les exigences en matière d’écoconception qui sont entrées en vigueur après leur mise sur le marché.
En revanche, les produits remanufacturés sont considérés comme de nouveaux produits et seront soumis aux exigences en matière d’écoconception, s’ils relèvent du champ d’application d’un acte délégué. La difficulté restera, au cas par cas, de distinguer ceux qui sont « reconditionnés » de ceux « remanufacturés ». Le texte donne une définition de ces deux notions : – le reconditionnement vise « les actions menées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit ou un produit mis au rebut en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise […] sur le marché » ; – le remanufacturage englobe, lui, les opérations par lesquelles « un nouveau produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et par lesquelles au moins une modification est apportée et a une incidence notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit ».
Dit autrement, il nous semble que le reconditionnement vise le prolongement du cycle de vie et le maintien des performances du produit, tandis que, dans le cas du remanufactu-rage, il s’agit plutôt d’un renouvellement du cycle de vie, avec généralement une amélioration des performances. Force est de constater qu’en pratique, la frontière risque parfois d’être difficile à appréhender…
Cette exclusion des biens d’occasion du champ du règlement Ecoconception est néanmoins une excellente nouvelle. La soumission des matériaux de réemploi à des exigences spécifiques risquerait de compromettre significativement leur remise en œuvre. Il faudrait soit les transformer (ce qui induirait des coûts extrêmement importants), soit renoncer tout bonnement à leur réemploi (avec l’impact environnemental induit par la mise au rebut…).
Des nouveaux produits et matériaux mieux réemployables. Le présent règlement ne fera donc pas obstacle au réemploi des produits d’ores et déjà présents sur le marché, et mieux encore, il favorisera le réemploi des futurs matériaux et équipements de construction.
En effet, pour les produits de construction dont les possibilités de réemploi et de reconditionnement sont des aspects pertinents en termes de durabilité (et ils sont légion), la Commission devrait imposer des exigences de performance afin de faciliter ces démarches visant à les réintégrer dans un nouveau bâtiment.
Mais surtout, ce sont les exigences d’information qui devraient faire la différence. En effet, à ce jour, le réemploi d’un matériau soulève principalement les questions suivantes : quelles sont ses performances initiales ? Quelles sont ses performances dans le cadre du réemploi, après un certain temps et un premier usage ? Quelles sont les conditions de sa réemployabilité et avec quels contrôles ? Quel protocole de démontage ? Quelles opérations de reconditionnement ? Contient-il des substances préoccupantes, voire interdites désormais de mise sur le marché ?
Aujourd’hui, ces questions sont généralement sans réponse, la documentation et les informations relatives au produit étant difficiles à collecter. La phase de caractérisation des matériaux puis de requalification technique est donc fastidieuse et surtout coûteuse. Les assureurs et les contrôleurs techniques exigent souvent des tests supplémentaires, qui sont définis au cas par cas.
Or, avec le passeport numérique de produit, les informations relatives à ses performances et son réemploi pourraient être disponibles en ligne et facilement compréhensibles par tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement au-delà du premier usage. En pratique, cet outil : – pourrait intégrer les informations utiles pour le démontage, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et la bonne gestion environnementale du produit à la fin de sa vie, ou encore l’emplacement des substances préoccupantes dans le produit (art. 7) ; – pourrait être mis à jour par tous les acteurs amenés à intervenir sur le produit, identifiés dans les actes délégués (réparateurs, professionnels de l’entretien, reconditionneurs, etc.) [art. 9] ; – devra en toute hypothèse être disponible pendant une période longue (qui sera fixée précisément dans l’acte délégué et variera en fonction du type de produit), même en cas de disparition du metteur sur le marché initial.
Le passeport aurait directement pour effet de faciliter le travail des diagnostiqueurs (ressources ou PEMD [« produits, équipements, matériaux et déchets »]), de simplifier la requalification technique des matériaux ou encore de booster les filières de reconditionnement et de remanufacturage des produits de construction qui commencent à apparaître (sanitaires, équipements électriques, moquette…).
Des exigences minimales pour des marchés publics écologiques
Ce règlement Ecoconception réalise une dernière belle avancée : l’intégration d’exigences minimales pour que les marchés publics privilégient les produits les plus performants en termes de durabilité. Ce dispositif n’est néanmoins pas entièrement nouveau pour la France.
Des exigences applicables aux marchés publics de travaux. Les exigences seront fixées pour la fourniture de groupes de produits spécifiques et elles seront applicables à tous les types de marchés prévoyant cette fourniture, notamment ceux de travaux (art. 65).
C’est la Commission européenne qui devra fixer ces exigences minimales via des actes d’exécution, sous la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution du marché. En pratique, elles pourront notamment prendre les formes suivantes : – des spécifications techniques obligatoires exigeant d’atteindre les meilleurs niveaux de performance possible prévus dans les actes délégués relatifs au groupe de produits concernés (par exemple, les deux meilleures classes de performance, les notes les plus élevées ou encore des exigences spécifiques en matière d’empreinte carbone) ; – des critères d’attribution, faisant l’objet d’une pondération minimale comprise entre 15 % et 30 % (par exemple, donner au contenu recyclé des produits concernés une pondération minimale comprise entre 20 % et 30 %) ; – des objectifs d’exécution du marché (par exemple, les acheteurs devraient consacrer au moins 50 % de leurs achats annuels de certains produits à ceux qui contiennent plus de 70 % de matériaux recyclables).
Articulation avec les dispositions nationales. Ces exigences relatives aux marchés publics écologiques sont des minima. Cela signifie tout d’abord que les Etats membres pourront encore fixer des règles plus ambitieuses et plus strictes et adopter des mesures pour des groupes de produits pour lesquels des exigences minimales n’ont pas été fixées par Bruxelles.
On notera qu’à ce stade, le droit français devra déjà probablement s’aligner sur ces exigences minimales. S’agissant par exemple des objectifs d’achat de produits durables, le règlement prévoit qu’il s’agira d’un pourcentage minimal de 50 % des marchés passés au niveau des acheteurs, ou à un niveau national agrégé, pour un groupe de produits, calculé sur une base annuelle ou pluriannuelle (art. 65).
Or les dispositifs actuels introduits par les lois Agec du 10 février 2020 ou Climat et résilience du 22 août 2021 sont a priori moins ambitieux. L’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées fixe des objectifs qui oscillent autour de 20 % en moyenne (3). Le Code de l’environnement prévoit, quant à lui, qu’« à compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux bio-sourcés ou bas carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique » (art. L. 228-4 C. env.).
Dans la mesure où il s’agit « d’exigences minimales », cela implique également que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices auront également la faculté de fixer des exigences supplémentaires et plus strictes dans leurs appels d’offres. Cette possibilité devra toutefois s’exercer dans le respect des règles classiques de la commande publique, et concrètement ne pas avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ou de favoriser certains fournisseurs.
Ces exigences minimales ne pourront être adoptées qu’à la suite des premiers actes délégués, et il faudra donc attendre probablement 2026 pour les voir apparaître.
(1) Règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.
(2) Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, en cours de révision. Le nouveau règlement, qui vient d’être adopté, sera prochainement publié au JOUE.
(3) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec), art. 58 ; décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

Ce qu’il faut retenir
- Le règlement Ecoconception du 13 juin 2024 va inciter les fabricants de matériaux et équipements de construction à améliorer la durabilité et la circularité de leurs produits. Des exigences de performance et l’obligation de créer un passeport de produit devraient permettre d’augmenter significativement leur réemploi.
- Parmi les groupes de produits concernés en priorité figurent le fer et l’acier, l’aluminium, les peintures, ainsi que les produits liés à l’énergie. Le ciment est également spécifiquement visé.
- La Commission européenne devra prendre des actes délégués pour fixer précisément ces exigences par groupe de produits et pourra établir également des exigences minimales applicables aux marchés publics afin de favoriser les produits les plus durables et issus de l’économie circulaire.