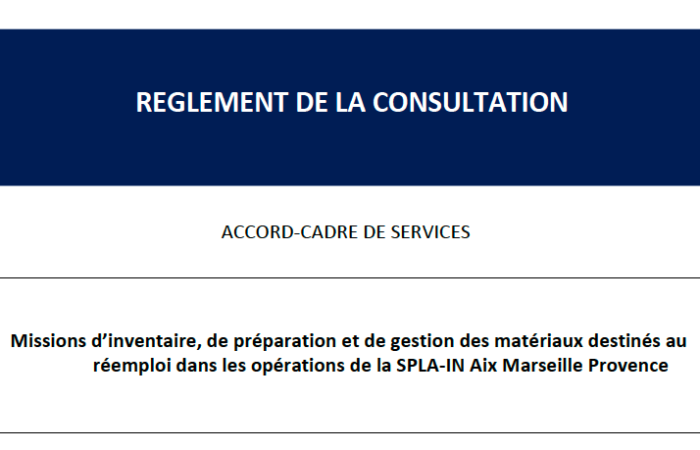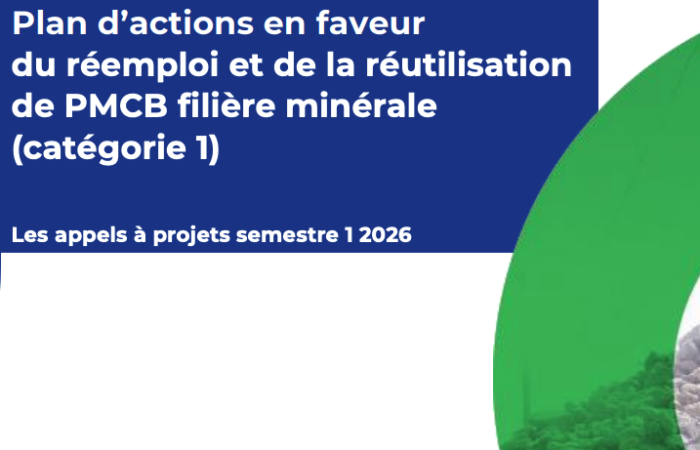Publié par Le Moniteur, le 18 février 2025
La prise en compte de la seconde main déclenche une révolution au long cours pour le BTP.

Le 7 janvier, le nouveau règlement européen sur les produits de construction (RPC 2024/3110) est entré en vigueur, au moins en partie. Profondément remanié par rapport à sa précédente version (RPC 305/2011), ce texte reflète les enjeux de l’époque : lutte contre le changement climatique, transition vers une économie circulaire, numérisation de nos sociétés. L’un de ses axes clés est la prise en compte du marché des produits de construction de réemploi, dans le but de le sécuriser et de le développer.
Un scope qui intègre désormais les produits usagés et remanufacturés
La grande révolution tient dans l’inclusion des produits usagés dans le champ d’application du RPC (article 2). Auparavant, il n’y avait qu’une mise sur le marché du produit, et sa seconde vie ne relevait pas du règlement. Désormais, il y a deux mises sur le marché : la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union européenne (à titre gratuit ou onéreux) par le fabricant ou l’importateur ; et la première mise à disposition sur le marché de l’UE d’un produit usagé après la désinstallation de ce produit (à nouveau, à titre gratuit ou onéreux). Le texte opère une distinction entre deux types de produits de réemploi (1) : les usagés et les remanufacturés.
Le « produit usagé » est celui qui n’est pas un déchet ou a cessé de l’être, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction et qui : – n’a pas « fait l’objet d’un processus allant au-delà du contrôle, du nettoyage ou de la réparation, par lequel des produits ou des composants de produits sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement » ; – ou a « fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation qui, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables, est considéré comme non essentiel pour la performance du produit ».
Si le processus de transformation est en revanche considéré comme essentiel pour la performance du produit, il s’agit alors d’un produit « remanufacturé ».
Une distinction encore floue. Ces définitions posent de nombreuses questions, les variations entre les traductions du RPC ne faisant qu’aggraver le flou. A première vue, on comprend que les produits usagés recouvrent ce qu’on appelle couramment la préparation au réemploi : contrôle, nettoyage, réparation, avec des opérations de transformation sans incidence sur les performances et les caractéristiques essentielles d’un produit. Par exemple, la préparation au réemploi d’ardoises naturelles ou de lavabos implique un tri/contrôle, un nettoyage/lavage et éventuellement des petites réparations ou transformations, comme un retaillement ou la réfection de trous de clous.
Le produit remanufacturé serait celui qui fait l’objet d’un renouvellement de son cycle de vie, et pas seulement une prolongation. Il impliquerait le changement de certains composants ou pièces. C’est le cas des équipements de génie civil ou des radiateurs en fonte (2).
A ce jour, de nombreuses questions restent en suspens, notamment celle de savoir où s’arrête le produit usagé et où commence le produit remanufacturé. Il faut en tout état de cause retenir que tous les matériaux qui ont été installés une première fois et qui ont vocation à être utilisés à nouveau, peu importe l’ampleur du processus de préparation ou de transformation nécessaire, sont susceptibles d’être soumis au RPC. Avec une exception toutefois pour le réemploi sur site, qui reste a priori non soumis à cette réglementation (point 34 du préambule et art. 3, points 4 et 5).
Les obligations des opérateurs qui mettent sur le marché des produits de réemploi
Le texte prévoit ainsi qu’est soumis aux mêmes obligations qu’un fabricant ou importateur un opérateur économique mettant sur le marché (art. 26, point 2) : – un produit usagé couvert par une spécification technique harmonisée qui prévoit explicitement des dispositions particulières pour les produits usagés ; – un produit usagé non couvert par une telle spécification mais importé d’un pays tiers (hors UE), qui est alors soumis à la spécification technique harmonisée applicable aux produits neufs ; – un produit remanufacturé et, dans ce cas, le nouveau règlement n’est pas clair sur la spécification technique applicable. L’interprétation la plus probable est qu’il est soumis à la même norme qu’un produit neuf, mais il faudrait a minima des dispositions spécifiques s’agissant des méthodes d’évaluation des performances puisque le processus industriel diffère.
Evaluation des performances. Concrètement, pour ces opérateurs économiques, la principale obligation consiste à veiller à ce que la performance du produit soit évaluée au niveau de ses caractéristiques essentielles, conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification applicables au titre de la norme harmonisée et du RPC (art. 22).
A noter que le texte consacre expressément le droit pour le metteur sur le marché de produits de réemploi d’exiger de ses fournisseurs et prestataires les informations dont il a besoin dans ce cadre, notamment celles sur l’utilisation antérieure et les opérations de dépose (art. 21, point 3).
Autre point intéressant, le règlement prévoit que, dans le cadre de l’évaluation du cycle de vie des produits usagés et remanufacturés, le calcul commencera à la dépose du produit et ne prendra pas en compte les étapes antérieures (art. 3, point 53).
Par la suite, les metteurs sur le marché devront établir une déclaration des performances et de conformité et apposer le marquage CE et le code d’identification unique du produit.
On notera que tout dispositif d’exemption ou de simplification de ces obligations pour les matériaux usagés ou remanufacturés a été écarté dans la version finale du texte, mais l’on peut espérer des normes harmonisées qu’elles prévoiront des aménagements et des dispositifs d’évaluation simplifiés (3).
D’autres obligations en lien avec l’aval de la chaîne s’ajoutent : fournir les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations de sécurité, étiqueter et identifier les produits réservés aux professionnels ; ou encore à plus long terme, de possibles obligations en lien avec le passeport numérique des produits.
Points importants à souligner : les spécifications techniques harmonisées applicables aux produits usagés se substitueront aux protocoles de requalification actuels, et les opérateurs du réemploi seront soumis à des formalités et à des coûts nouveaux.
Les obligations des fabricants et des maîtres d’ouvrage pour favoriser le réemploi
Si le RPC encadre le réemploi en aval, après la désinstallation, il a également vocation à le favoriser en amont, lors de la fabrication. A ce titre, les produits de construction mis sur le marché disposeront d’une fiche d’information fournissant les recommandations pour la réparation, la désinstallation, le réemploi ou encore le remanufacturage (annexe IV). Ce document, qui accompagnera la vente, sera aussi disponible via le passeport numérique du produit, qui intégrera en outre la déclaration des performances et de la conformité (art. 76). Ce passeport devra être disponible au moins dix ans à compter de la mise à disposition du produit (art. 75), ce qui devrait faciliter significativement le réemploi en bénéficiant d’une traçabilité complète et aisément accessible.
En outre, pour soutenir le marché des produits de construction circulaires, le règlement prévoit que la Commission européenne adopte des actes délégués afin de spécifier des exigences minimales obligatoires dans les marchés publics, qui pourront notamment concerner les produits usagés et remanufacturés (art. 83).
Des dispositions à affiner
La révolution a commencé, mais elle prend du temps. La Commission, assistée d’un groupe d’experts, doit désormais établir un plan de travail en vue d’élaborer des spécifications techniques harmonisées pour certaines familles de produits (liste à l’annexe VII). Elle doit déterminer notamment celles qui doivent exclure ou inclure les produits de réemploi. Ce premier plan de travail devra être publié au plus tard le 8 janvier 2026.
Les filières européennes du réemploi ont donc, qu’elles le veuillent ou non, atteint l’âge adulte : celui du lobbying. Il leur revient de s’unir et de s’assurer que leur voix sera prise en compte, afin de ne pas subir une surréglementation et de garantir que les exigences et les méthodes d’évaluation sont adaptées aux pratiques et aux investissements déjà réalisés.
(1) Les autres hypothèses de réemploi (produits issus de surplus de chantier, produits invendus ou encore produits déclassés ou réemployés à des fins décoratives) qui avaient pu figurer dans les versions précédentes du texte ne sont plus mentionnées.
(2) Le RPC fait référence à la possibilité d’exiger le recours à des éléments recyclés dans le cadre du remanufacturage (point 36 du préambule).
(3) Le RPC rappelle que la Commission européenne devrait viser à réduire la charge administrative pour les entreprises et tenir compte des besoins des PME lors de l’élaboration des normes harmonisées (point 101 du préambule).
Ce qu’il faut retenir
- Le nouveau règlement européen sur les produits de construction (RPC) est entré en vigueur le 7 janvier 2025. Il vise notamment à sécuriser et développer le marché du réemploi. Désormais, la seconde vie des produits relève du RPC, que ce soit pour des produits usagés ou remanufacturés.
- Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits de réemploi sont soumis aux mêmes obligations qu’un fabricant ou importateur : évaluation de la performance du produit, marquage CE, etc.
- Le RPC vise aussi à favoriser le réemploi en amont – au stade de la fabrication des produits – via une fiche d’information visant à guider la dépose et le réemploi et via le passeport numérique.